 UN
POLYTECHNICIEN GARAGISTE...
UN
POLYTECHNICIEN GARAGISTE...Exposition réalisée par Jean-Baptiste
Garache
au musée de La
Colline de l'Automobile en octobre 1993
à
l'occasion de la sortie de l'ouvrage posthume de Grégoire,
"Toutes
mes Automobiles" (Editions Massin)
 UN
POLYTECHNICIEN GARAGISTE...
UN
POLYTECHNICIEN GARAGISTE...
 Jean-Albert
Grégoire naît le 7 juillet 1899 à Paris. Bon joueur de rugby et champion de France du 100 mètres
aux jeux interalliés 1917, il entre à l'école
Polytechnique en 1919, pour le prestige de l'uniforme. A ses heures
perdues, il étudie le droit et conduit une moto
Harley-Davidson. Compensant des débuts professionnels peu
enthousiasmants dans les métiers à tisser et la
recherche pétrolière, il voue une admiration sans
bornes à la course automobile (Bugatti et Amilcar, dont il
achète une CC en 1922, puis une Scap) et au pilote Robert
Benoist qui donnera à Delâge le titre de champion du
monde des constructeurs en 1927. Vers 1924, Grégoire rencontre
Pierre Fenaille dans un tennis de Neuilly, appartenant à
la famille de ce dernier, de riches industriels du pétrole.
Pierre, fils de famille et ingénieur montrant de réelles
dispositions pour la mécanique, construit, en véritable
émule de De Dion-Bouton, une voiture à vapeur qui
remporte un vif succès dans leur groupe d'amis. Il partage
avec Grégoire la passion de la course, que les deux amis
mettent en pratique au volant d'une Amilcar Grand Sport au Rallye de
Monte-Carlo en janvier 1925. Grégoire aborde ensuite son
premier métier automobile en achetant à l'été
1925 le Garage des Chantiers (concession Mathis et Delâge) à
Versailles, pensant ainsi faciliter sa participation aux rallyes, .
Il court encore au rallye de Monte-Carlo sur Majola en janvier 1926
et sur Mathis et Bugatti en janvier 1927. Mais bientôt lassés
de piloter des modèles existants, les deux amis décident
de construire leur propre bolide, ou au mieux "quelques voitures
de course".
Jean-Albert
Grégoire naît le 7 juillet 1899 à Paris. Bon joueur de rugby et champion de France du 100 mètres
aux jeux interalliés 1917, il entre à l'école
Polytechnique en 1919, pour le prestige de l'uniforme. A ses heures
perdues, il étudie le droit et conduit une moto
Harley-Davidson. Compensant des débuts professionnels peu
enthousiasmants dans les métiers à tisser et la
recherche pétrolière, il voue une admiration sans
bornes à la course automobile (Bugatti et Amilcar, dont il
achète une CC en 1922, puis une Scap) et au pilote Robert
Benoist qui donnera à Delâge le titre de champion du
monde des constructeurs en 1927. Vers 1924, Grégoire rencontre
Pierre Fenaille dans un tennis de Neuilly, appartenant à
la famille de ce dernier, de riches industriels du pétrole.
Pierre, fils de famille et ingénieur montrant de réelles
dispositions pour la mécanique, construit, en véritable
émule de De Dion-Bouton, une voiture à vapeur qui
remporte un vif succès dans leur groupe d'amis. Il partage
avec Grégoire la passion de la course, que les deux amis
mettent en pratique au volant d'une Amilcar Grand Sport au Rallye de
Monte-Carlo en janvier 1925. Grégoire aborde ensuite son
premier métier automobile en achetant à l'été
1925 le Garage des Chantiers (concession Mathis et Delâge) à
Versailles, pensant ainsi faciliter sa participation aux rallyes, .
Il court encore au rallye de Monte-Carlo sur Majola en janvier 1926
et sur Mathis et Bugatti en janvier 1927. Mais bientôt lassés
de piloter des modèles existants, les deux amis décident
de construire leur propre bolide, ou au mieux "quelques voitures
de course".
L'AVENTURE TRACTA

 Pierre
Fenaille est un personnage qui met un point d'honneur à être
original : en 1926, il remporte Paris-Nice dans la catégorie 5
litres, dormant dans l'habitacle de son coupé Farman, pendant
que son chauffeur conduit. C'est lui qui incite Grégoire à
choisir la disposition à traction avant, qui à 1'époque
est encore un non-sens pour tous les constructeurs. Elle est rendue
possible grâce au joint "homocinétique"
dont le brevet sera déposé le 8 décembre 1926.
Le prototype Tracta Gephi à moteur 4 cylindres Scap est
commencé en novembre 1925. Il roule en juillet 1926. Son
comportement à la coupe de l'Armistice le 1 1 novembre 1926
(premier dans la catégorie 1100 cm3) et aux courses de côte
de La Turbie et du Mont-Agel incite ses concepteurs à le
présenter aux 24 heures du Mans le 15 juin 1927, malgré
le terrible accident qui décime l'équipe Tracta le
matin même de la compétition. Fenaille dans le coma,
Grégoire court l'épreuve contusionné à la
tête, et réussit à se qualifier. Par la suite, en
1928, 1929 et 1930, d'autres Tracta se distinguent en remportant la
coupe biennale. Depuis le 27 janvier 1927, Tracta est devenu une
société, qui a son stand au Salon de l'Auto, et qui
produit à Asnières des véhicules en petite
série. Après les types A et B dérivés
de la Gephi, on retiendra le type D, construit à plus
de 100 exemplaires, le type E 6 cylindres (le premier qui
satisfait vraiment Grégoire), et les types F et G
à moteur Hotchkiss. L'énorme prix de revient et de
vente de ces véhicules obligent Grégoire à
cesser leur fabrication en 1933. Mais Tracta a incité par ses
brevets innovants d'autres constructeurs (DKW, Adler, Citroën) à
tenter la solution de la traction avant.
Pierre
Fenaille est un personnage qui met un point d'honneur à être
original : en 1926, il remporte Paris-Nice dans la catégorie 5
litres, dormant dans l'habitacle de son coupé Farman, pendant
que son chauffeur conduit. C'est lui qui incite Grégoire à
choisir la disposition à traction avant, qui à 1'époque
est encore un non-sens pour tous les constructeurs. Elle est rendue
possible grâce au joint "homocinétique"
dont le brevet sera déposé le 8 décembre 1926.
Le prototype Tracta Gephi à moteur 4 cylindres Scap est
commencé en novembre 1925. Il roule en juillet 1926. Son
comportement à la coupe de l'Armistice le 1 1 novembre 1926
(premier dans la catégorie 1100 cm3) et aux courses de côte
de La Turbie et du Mont-Agel incite ses concepteurs à le
présenter aux 24 heures du Mans le 15 juin 1927, malgré
le terrible accident qui décime l'équipe Tracta le
matin même de la compétition. Fenaille dans le coma,
Grégoire court l'épreuve contusionné à la
tête, et réussit à se qualifier. Par la suite, en
1928, 1929 et 1930, d'autres Tracta se distinguent en remportant la
coupe biennale. Depuis le 27 janvier 1927, Tracta est devenu une
société, qui a son stand au Salon de l'Auto, et qui
produit à Asnières des véhicules en petite
série. Après les types A et B dérivés
de la Gephi, on retiendra le type D, construit à plus
de 100 exemplaires, le type E 6 cylindres (le premier qui
satisfait vraiment Grégoire), et les types F et G
à moteur Hotchkiss. L'énorme prix de revient et de
vente de ces véhicules obligent Grégoire à
cesser leur fabrication en 1933. Mais Tracta a incité par ses
brevets innovants d'autres constructeurs (DKW, Adler, Citroën) à
tenter la solution de la traction avant.
UNE USINE A BREVETS
 Si
en 1933, Tracta ne fabrique plus d'automobiles, son activité
principale est axée sur l'exploitation du brevet du joint
homocinétique, dont les demandes de brevets étrangers
commencent dès 1928. Le brevet anglais est obtenu rapidement,
celui des Etats-Unis en lè33 seulement, et l'allemand en 1936.
Entre-temps, les firmes Adler et D.K.W. ont sorti
depuis 1931 des dizaines de milliers de véhicules équipés
du joint Tracta, sur lesquels elles n'ont encore payé aucun
droit. Une longue procédure suit , a l'issue de laquelle une
partie des redevances seulement est réglée. Par la
suite, l'armée allemande utilisera sans droits le joint
Tracta, ce qui incitera Grégoire à offrir le brevet au
gouvernement français à la veille de la guerre. En
France, le constructeur Rosengart produit l' Adler Trumpf
sous licence en 1932 : c'est la Supertraction. Jean-Albert
Grégoire participe à la mise au point de la
transmission de la nouvelle Citroën 7 à traction avant,
mais pour des raisons d'échauffement dû à une
modification du dessin initial du joint, celui-ci ne l'équipe
que jusqu'en 1935. Donnet en 1932, et Chenard & Walcker
en 1933 sortent sans grand succès des "traction avant"
sous licence Grégoire. C'est en se présentant au
concours de la Société des Ingénieurs de l'
Automobile pour une petite voiture 2 places/75 km/h que Grégoire
est amené à présenter un nouveau brevet : la
carcasse coulée en aluminium, d'abord adaptée à
une Adler Junior de série, puis adoptée par le
constructeur Hotchkiss pour la marque Amilcar qu'il avait
rachetée. L'Amilcar Compound est présentée
au Salon de 1937, et remporte un bon accueil commercial jusqu'à
la deuxième guerre mondiale.
Si
en 1933, Tracta ne fabrique plus d'automobiles, son activité
principale est axée sur l'exploitation du brevet du joint
homocinétique, dont les demandes de brevets étrangers
commencent dès 1928. Le brevet anglais est obtenu rapidement,
celui des Etats-Unis en lè33 seulement, et l'allemand en 1936.
Entre-temps, les firmes Adler et D.K.W. ont sorti
depuis 1931 des dizaines de milliers de véhicules équipés
du joint Tracta, sur lesquels elles n'ont encore payé aucun
droit. Une longue procédure suit , a l'issue de laquelle une
partie des redevances seulement est réglée. Par la
suite, l'armée allemande utilisera sans droits le joint
Tracta, ce qui incitera Grégoire à offrir le brevet au
gouvernement français à la veille de la guerre. En
France, le constructeur Rosengart produit l' Adler Trumpf
sous licence en 1932 : c'est la Supertraction. Jean-Albert
Grégoire participe à la mise au point de la
transmission de la nouvelle Citroën 7 à traction avant,
mais pour des raisons d'échauffement dû à une
modification du dessin initial du joint, celui-ci ne l'équipe
que jusqu'en 1935. Donnet en 1932, et Chenard & Walcker
en 1933 sortent sans grand succès des "traction avant"
sous licence Grégoire. C'est en se présentant au
concours de la Société des Ingénieurs de l'
Automobile pour une petite voiture 2 places/75 km/h que Grégoire
est amené à présenter un nouveau brevet : la
carcasse coulée en aluminium, d'abord adaptée à
une Adler Junior de série, puis adoptée par le
constructeur Hotchkiss pour la marque Amilcar qu'il avait
rachetée. L'Amilcar Compound est présentée
au Salon de 1937, et remporte un bon accueil commercial jusqu'à
la deuxième guerre mondiale.
 DEUX
PUCES EN ALUMINIUM
DEUX
PUCES EN ALUMINIUM
A la fin de 1940, devant les restrictions de production automobile provoquées par la guerre, Jean-Albert Grégoire accepte la proposition d'Henry de Raemy de la C.G.E. d'étudier une petite voiture électrique qui serait construite par la société des accumulateurs Tudor. Si elle comporte une carcasse coulée, son moteur est disposé centralement, avec transmission aux roues arrière, pour des raisons d'encombrement des batteries. Le prototype CGE-Tudor roule en février 1941, la voiture carrossée en avril, et 200 exemplaires sortent des chaînes jusqu'à la fin de 1944. En 1942, ce modèle parcourt Paris-Tours (250 km) à 42,32 km/h de moyenne, ce qui constitue le record mondial sans recharge, toujours valable cinquante ans après. Parallèllement, en prolongement du concours de la S.I.A il étudie avec l'Aluminium Français un nouveau prototype de petite voiture à carcasse coulée, à traction avant, dont le cahier des charges précise : 4 places, 400 kilos, 4 litres aux 1 00 km, 90 km/h. Le premier coup de crayon donné en janvier 1941, la voiture carrossée roule en juillet 1942. Elle bénéficie d'abord d'une suspension à anneaux concentriques Neiman, avant d'être équipée de la fameuse suspension à flexibilité variable, et un moteur bicylindre refroidi par air situé devant le train avant, pour une meilleure tenue de route et habitabilité. En 1945, la voiture dénommée Aluminium Français Grégoire subit quelques modifications afin de permettre sa fabrication par Simca, dont Grégoire est devenu directeur général technique. Mais devant l'opposition du président Pigozzi de Simca, la Simca-Grégoire n'est jamais mise en production. C'est finalement Panhard qui, au termes d'un accord passé en 1943, reprend l'A.F.G. en lui donnant les lignes de la Dyna.
SOUS LE SIGNE DE L'AERODYNAMIQUE
 |
|
Dès 1944, désirant étudier une
grosse voiture de 2 litres de cylindrée, JAG demande à
l'ingénieur Marcel Sédille, de la société
Rateau, d'étudier l'écoulement de l'air sur une
maquette aux formes tr ès
proches de l'A.F.G., puis d'en dessiner une autre de la meilleure
forme aérodynamique possible, et enfin de comparer les
résultats à une maquette de 11 légère
Citroën. L'affinement de la maquette aérodynamique en
1946 donnera le prototype Grégoire (ou Tracta) R,
présenté au Salon de 1947, et pour la construction
duquel Hotchkiss s'engage par contrat en juin 1949. Les
premières Hotchkiss Grégoire sont livrées
en 1951, juste avant que la firme Hotchkiss ne doive stopper sa
production pour des raisons financières. Un coupé
dessiné par Chapron et un cabriolet sont cependant
produits àquelques exemplaires. Un prototype de Frégate
Renault-Grégoire, étudié en 1953, ne verra
pas le jour. La même année, la
ès
proches de l'A.F.G., puis d'en dessiner une autre de la meilleure
forme aérodynamique possible, et enfin de comparer les
résultats à une maquette de 11 légère
Citroën. L'affinement de la maquette aérodynamique en
1946 donnera le prototype Grégoire (ou Tracta) R,
présenté au Salon de 1947, et pour la construction
duquel Hotchkiss s'engage par contrat en juin 1949. Les
premières Hotchkiss Grégoire sont livrées
en 1951, juste avant que la firme Hotchkiss ne doive stopper sa
production pour des raisons financières. Un coupé
dessiné par Chapron et un cabriolet sont cependant
produits àquelques exemplaires. Un prototype de Frégate
Renault-Grégoire, étudié en 1953, ne verra
pas le jour. La même année, la  Compagnie
Electromécanique présente la première voiture à
turbine française, la Socema-Grégoire,
bénéficiant d'un Cx époustouflant de 0,18.
C'est alors que Grégoire, las de l' échec commercial de
la Hotchkiss, fait dessiner par Chapron sans aucun critère
aérodynamique, un cabriolet sport à mécanique
Grégoire R gonflée par un compresseur Constantin
(1956). Cette Grégoire Sport, vendue à un prix
prohibitif (4 millions de francs) est construite à une dizaine
d'exemplaires.
Compagnie
Electromécanique présente la première voiture à
turbine française, la Socema-Grégoire,
bénéficiant d'un Cx époustouflant de 0,18.
C'est alors que Grégoire, las de l' échec commercial de
la Hotchkiss, fait dessiner par Chapron sans aucun critère
aérodynamique, un cabriolet sport à mécanique
Grégoire R gonflée par un compresseur Constantin
(1956). Cette Grégoire Sport, vendue à un prix
prohibitif (4 millions de francs) est construite à une dizaine
d'exemplaires.
CGE: LE RETOUR
 Conjointement
à l'étude de nouveaux prototypes, J.A. Grégoire
et la Société Tracta ne cessent de déposer et
d'exploiter de nouveaux brevets, en particulier celui de la
suspension à flexibilité variable, adaptée
à de nombreux véhicules dont la Citroën 15 cv, et
de la suspension à coussin d'air atmosphérique
pneumatique qui équipe 1,5 million de Renault Dauphine
(dites "aérostables") à partir de 1960, et
une suspension oléopneumatique en 1963. La
diversification amène même l'entreprise à
concevoir une suspension po
Conjointement
à l'étude de nouveaux prototypes, J.A. Grégoire
et la Société Tracta ne cessent de déposer et
d'exploiter de nouveaux brevets, en particulier celui de la
suspension à flexibilité variable, adaptée
à de nombreux véhicules dont la Citroën 15 cv, et
de la suspension à coussin d'air atmosphérique
pneumatique qui équipe 1,5 million de Renault Dauphine
(dites "aérostables") à partir de 1960, et
une suspension oléopneumatique en 1963. La
diversification amène même l'entreprise à
concevoir une suspension po ur
les brancards destiné aux transport des blessés
de la colonne vertébrale, oeuvre pour laquelle Grégoire
sera chaleureusement remercié par le Général
de Gaulle. C'est à la fin de 1968 que Raymond Pelletier,
directeur général de la C.G.E. demande à
Grégoire l'avant-projet de l'étude d'une
fourgonnette électrique. Une fois l'avant-projet accepté,
la décision de construire le véhicule est prise en
avril 1970, et ses premiers tours de roue surviennent le 18 mars
1971. Les prototypes n° 1 et 2 bénéficiant d'une
transmission par courroie crantée peu satisfaisante, une
transmission par pont est adoptée pour le n° 3 qui roule
en mars 1972, doté évidemment de la suspension
pneumatique à basse pression qui équipait la Dauphine
Aérostable. La CGE-Grégoire est produite en
petite série jusqu'en 1974. Depuis cette date, et jusquà
son décès survenu en août 1992 l'ingénieur
Grégoire s'est consacré de plus en plus à
l'écriture, discipline où il excellait comme
romancier depuis la publication de la plaquette "L'ingénieur
de l'Automobile" en 1947. Un espace présentant ses 12
prototypes lui est réservé depuis 1992 au Musée
de l'Automobile de La Défense.
ur
les brancards destiné aux transport des blessés
de la colonne vertébrale, oeuvre pour laquelle Grégoire
sera chaleureusement remercié par le Général
de Gaulle. C'est à la fin de 1968 que Raymond Pelletier,
directeur général de la C.G.E. demande à
Grégoire l'avant-projet de l'étude d'une
fourgonnette électrique. Une fois l'avant-projet accepté,
la décision de construire le véhicule est prise en
avril 1970, et ses premiers tours de roue surviennent le 18 mars
1971. Les prototypes n° 1 et 2 bénéficiant d'une
transmission par courroie crantée peu satisfaisante, une
transmission par pont est adoptée pour le n° 3 qui roule
en mars 1972, doté évidemment de la suspension
pneumatique à basse pression qui équipait la Dauphine
Aérostable. La CGE-Grégoire est produite en
petite série jusqu'en 1974. Depuis cette date, et jusquà
son décès survenu en août 1992 l'ingénieur
Grégoire s'est consacré de plus en plus à
l'écriture, discipline où il excellait comme
romancier depuis la publication de la plaquette "L'ingénieur
de l'Automobile" en 1947. Un espace présentant ses 12
prototypes lui est réservé depuis 1992 au Musée
de l'Automobile de La Défense.
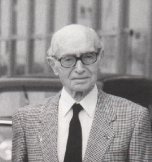 Jean-Albert
Grégoire s'est éteint le 19 août 1992.
Jean-Albert
Grégoire s'est éteint le 19 août 1992.